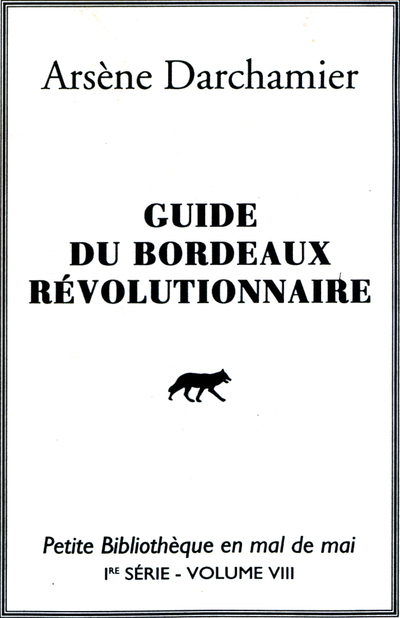-
Guide du Bordeaux révolutionnaire (Arsène Darchamier, alias Arthur)
FAUTE de patience pour écrire un livre d'importance égale à son sujet, je ne plancherai pas sur un Guide du Bordeaux contre-révolutionnaire. Une ville qui doit la fortune de sa bourgeoisie au commerce triangulaire, c'est-à-dire au trafic des Noirs d'Afrique revendus comme esclaves en Amérique, et dont l'opulence ostentatoire s'aligne dans l'austérité des façades compassées qui bordent ses cours rectilignes, flanqués d'hôtels et de couvents, ne mérite pas qu'un esprit libre fasse l'historique de son lourd passé.
Messire Michel de Montaigne, esprit curieux, s'essaya un temps à conseiller le parlement de la ville selon des préceptes depuis longtemps tombés en désuétude aujourd'hui. Il est vrai qu'il avait pu être influencé par son ami Étienne de La Boétie qui n'était pas fanatique du gouvernement étatique mais plutôt porté sur l'administration des choses par les intéressés eux-mêmes. Et, par temps de choléra, Montaigne abandonna ses incurables concitoyens à une destinée peu enviable.
Les turpitudes bordelaises ne datent pas de Mauriac. Mais aborder ce chapitre requerrait déjà plusieurs forts volumes. Passons. Les ignominies perpétrées avant, pendant, à la fin de la guerre et à la libération y surpassent de beaucoup ce qu'on a pu connaître à Nevers ou en d'autres coins de la douce France. Mais c'est parfaitement dans la ligne des traditions locales puisqu'on y avait vu en 1871 la courageuse Assemblée nationale, cette chambre de ploucs réunie au Grand Théâtre, vendre, à la suite de ses généraux, le pays qu'ils s'étaient arrogés le droit de défendre. En mettant à part l'intelligence éclairée d'un Montesquieu qui prônait certaine idée de la démocratie, on devine aisément, depuis la baronnie de Chaban, à qui appartient Bordeaux.
Je propose donc ici un ouvrage court mais documenté.
EN 1967, le grand port atlantique se mourait doucement. Les raffineries, le gaz et le pétrole avaient déplacé en aval, au bec d'Ambez, les activités et le trafic soutenus auparavant par le commerce maritime avec les colonies d'Afrique et d'Amérique. Le Bordelais est avant tout colonialiste et négociant ; il n'est pas moins esclavagiste et a su parquer dans quelques quartiers défavorisés ses Noirs et ses Maghrébins. En 1967 donc, quelques jeunes gens en rupture de ban s'ennuyaient ferme à Bordeaux, rêvant désespérément d'en découdre avec ces « Chartrons » qui monopolisaient les meilleurs vins, classés dès 1855 et vendus à des prix prohibitifs. On n'avait pas vu d'émeute depuis la Fronde… C'est dans ce ciel grisâtre — et qui, à certains, devait paraître serein — qu'éclata le 31 mars 1968 un tract signé d'un Comité de salut public des Vanda listes jusqu'alors inconnu : cette feuille était un tissu d'injures adressées à toutes les autorités (parents, professeurs, flics et curetons) et à tous les impuissants (étudiants en particulier) (1). Ce fut le début de l'affolement chez les fils à bourgeois des quartiers protégés qui fréquentaient l'université.
En revanche, la minuscule nébuleuse rassemblée autour de ces « vandalistes » se retrouvait, pour commenter les événements déjà marquants de ce printemps-là, à Saint-Michel, avant-poste des Capucins (le marché de nuit), quartier où les anarchistes espagnols réfugiés avaient fait souche. Justement, leurs enfants avaient l'âge de nos beaux diables, et n'étaient pas moins révoltés par la bassesse du monde. Et ceux-là venaient d'une autre université, où on rencontrait aussi les petites prolotes de banlieue que la milice chabano-girondine — les SAC locaux —, composée en partie de maquereaux, n'hésitait pas à prostituer.
Maintenant que le décor est planté, allons-y gaiement. Le larron faisant facilement l'occasion, et l'inconscience de la très grande jeunesse aidant — oui, je sais la part énorme d'inculture qu'il y a dans l'inconscience, mais les écoles de la IVe et de la Ve République ne m'ont inculqué que cette « science des ânes » qui se résumait à savoir lire, écrire et compter —, le larron donc, narrais-je… eut l'idée, avec quelques camarades (nous nous connaissions de trop peu pour qualifier d'amitié, sentiment dont nous doutions comme de l'univers entier, nos relations)… ou l'idée nous prit, les circonstances étant propices, de nous emparer de ce lourd pavé cultureux de Grand Théâtre que les Bordelais de « la haute » considéraient comme leur temple, avachi au cœur figé de la ville pour frapper d'indigestion toute manifestation créatrice.
Le fait est qu'il n'y avait pour le défendre que deux agents en faction à l'entrée des artistes. Nous fûmes trois, puis dix à les bousculer, mais par un prompt renfort typique de ce mois de mai deux cents personnes déboulèrent sur ces « entrefêtes », peut-être davantage. Il y eut des parlotes, le préfet en personne, un professeur vaguement maoïste et un peu fou se mit en tête de prêcher — enfin bref, on m'empêcha, devant l'évacuation entreprise par les gendarmes accourus au secours, de mettre le feu au monument, ce qui eût été une mesure salutaire à tous points de vue (y compris celui de Stendhal). Il me faut piteusement reconnaître que mes bombes incendiaires se réduisaient à des allumettes.
Nous étions une douzaine à former une bande relativement homogène d'esprits forts et de fortes têtes dont l'ambition avouée était de « tout foutre par terre » et de chercher à faire « quelque chose de marrant ». Nous découvrions pêle-mêle : les jeux surréalistes et la fameuse révolution sexuelle épinglée par Reich (nous en usions avec le plus parfait mauvais goût), la dérive situationniste et les conseils ouvriers, dont Debord nous faisait le panégyrique par correspondance. Nous eûmes bientôt la sympathie de pas mal d'Enragés, car Patrick Cheval nous avait vaillamment aidés à faire de notre proclamation programmatique une provocation assez réussie pour la capitale de la Guyenne.
Revenons à nos moutons de mai. Le lendemain, 25 mai 1968 — je rectifie au passage la date erronée notée dans l'ouvrage signé d'abord de Viénet —, nous ne nous ennuyâmes pas. Plusieurs centaines de personnes, en effet, se portèrent avec des intentions menaçantes devant le palais Rohan, siège de la mairie de Bordeaux sur la place Pey-Berland, où règne aussi la cathédrale ; quelques-uns furent même s'enquérir d'un bélier pour s'attaquer aux imposantes portes de l'édifice. Nous ne pouvions évidemment savoir à l'époque que les caves du palais regorgeaient de vieux fusils et armes réquisitionnés à la faveur de la « libération » chabanesque (sacré Delmas !).
Le préfet de police, la veille si arrangeant sous les décors, donna ce coup-ci l'ordre de cogner — dans la rue. (Il faut rappeler que, la veille, la révolte avait été chaude, tout particulièrement à Paris et à Lyon.) L'effet surprise d'une cohorte de deux cents CRS chargeant à la grenade lacrymogène vida la place en provoquant un mouvement de panique. Fuite regrettable, car nous perdîmes là un centre stratégique. L'ordre se hâta d'ailleurs de poster sa force aux coins de rues commandant l'accès aux quartiers populaires de Mériadeck et de Saint-Pierre, quoique imparfaitement. Car, essayant de faire refluer la foule qui s'amalgamait maintenant de partout, ils se heurtèrent à une résistance inattendue. Observons encore que la flicaille mercenaire commençait à perdre le moral, un peu comme (toutes proportions gardées, bien entendu) les GIs au Viêt-nam. Ils durent établir leur ligne place de la République, où trône imperturbablement le palais d'injustice. (Qui aurait dit alors qu'on y verrait un jour un vieillard nommé Papon y répondre de ses bons et loyaux services ?)
Les hostilités s'étaient déclenchées aux alentours de dix-sept heures. En moins d'une heure, nous avions reculé de peu, mais la place centrale était restée aux mains de l'ennemi, qui la défendit cours Dufour-Dubergier par des charges successives, auxquelles répondait l'artillerie des pavés qui volaient bas et l'enthousiasme de la jeunesse pour le baston, les filles n'étant pas les dernières. Chargeant quelquefois jusqu'au cours Pasteur, les cognes furent toujours repoussés, au prix de quelques coups de matraques, pendant que les barricadiers se diligentaient cent mètres plus bas.
Je m'inquiétai d'évaluer le périmètre que nous occupions : il suffisait de faire le tour des obstacles élevés pour barrer les rues. Réputée aujourd'hui être un objet romantique, la barricade est passée de mode ; c'est plus que dommage, car il s'agit là d'un jeu d'invention renouvelée que chaque époque a traité selon son génie propre. Si en 68 les barricades ne se sont pas terminées en tragédie, comme tant de fois précédentes, le côté ludique en a redéfini le caractère : la barricade fait excellemment fonction de mobilier urbain ; trouvant immédiatement l'emploi des objets et des signes de l'aliénation marchande (tels automobiles et sémaphores), elle a permis une circulation nouvelle dans les rues enrichies d'inscriptions rebelles et changé la ville en terrain d'exploration réelle.
Malgré l'aide des anciens d'Espagne venus nous conseiller habilement sur la stratégie des batailles de rues et l'art de déverrouiller les canalisations réservées aux pompiers pour noyer les gaz lacrymogènes, cela vira bientôt à la guerre de position. Le fait est que la puissance militaire se résumait à ces quelques CRS, la bonne ville de Bordeaux, trop sûre de ses cons de tribuables, ayant expédié dans l'urgence ses gardiens à Paris qui brûlait… Nos positions tenaient la rue de Crussol et le cours Pasteur et, de la place de la Victoire au sud jusqu'aux quais de la Garonne à l'est, l'émeute était chez elle. Je retrouvai bientôt des éléments de notre bande que Jean-Marc Anton avait dotés de casquettes paramilitaires volées je ne sais où, pour jouer, disait-il, au « retour de la colonne Makhno ». Il nous parut qu'il était temps de reprendre nous aussi des forces ; et partîmes donc nous restaurer, de chat plutôt que de lapin (comme nous l'apprirent les journaux par la suite), dans un restaurant viêt où la modicité des prix attirait notre genre de clientèle — nous mangions et buvions alors à peu près n'importe quoi, la quantité l'emportant haut la glotte sur la qualité…
Il fallut qu'au sortir de ce lieu de perdition du foie et de l'estomac nous tombions sur un imbécile à prétention d'intellectuel ou à tout le moins d'artiste, dont j'ai heureusement oublié le nom et qui, repérant dans notre euphorique troupe quelques visages de connaissance, nous apostropha en termes choisis : « Bandes de salauds, vous étiez en train de vous goberger pendant qu'on se bat ! » Il avait de fait récolté une estafilade au cours d'une escarmouche… (Mais j'ai pu quelquefois arguer de ce valeureux témoignage pour jurer contre toute évidence que je n'avais en aucune façon participé à l'émeute ! Hélas, l'appareillage journalistique était plus implacable, qui m'avait déjà cliché.)
J'ouvre ici deux parenthèses pour mieux rendre sensible l'ambiance qui régnait ce soir-là à Bordeaux. Avant d'aller dîner, après un tour de nos ouvrages fortifiés, j'étais revenu au carrefour des cours Pasteur et Victor-Hugo où se déroulaient maintenant des pourparlers entre, côté ordre officiel, je ne sais quel gradé de la mairie ou de la préfecture et M. le doyen de la fac de lettres, dont le bâtiment était occupé dans son dos. Réunion en cercle, formé moitié par une douzaine de CRS casqués et mousquetonnés et moitié par les héros militants de la gauche (mitterrandienne) du syndicat étudiant, lesquels n'allaient pas tarder à se convertir en trotskistes — toujours une mode de retard chez les fils de notaire ! Je ramenai ma fraise pour m'élever ingénument mais véhémentement contre des discussions empreintes d'une notable quantité d'importance nulle, objectant que l'heure était au conflit. Propos qui n'étaient pas du goût d'un bureaucrate de service qui, m'interpellant par mon nom, me projeta brutalement dans cette arène : « Ah, tu veux te battre, Darchamier ? eh bien, vas-y ! » Je m'aperçus que j'étais seul dans un environnement plus qu'hostile et, instruit par l'expérience de quelques semaines de troubles et de manifesta-tions où je m'étais retrouvé plusieurs fois isolé aux prises avec ces étudiants de la pensée-mao, trotski, lénine ou sartre, j'optai pour une fugace retraite.
Par ailleurs, au cours de l'heure précédant ces propositions d'armistice, j'avais pu me rendre compte de la détermination du populaire qui occupait la rue et n'entendait visiblement pas la céder sans que ça saigne. C'est l'une des impressions les plus fortes que j'ai reçues de 68 : ce que les intellos ont coutume d'appeler « les masses » voue une haine inextinguible aux autorités qu'elle subit en temps ordinaire sans broncher, ainsi qu'aux sbires qui les représentent aux croisements. C'est là qu'on pouvait voir à l'œuvre le retour du refoulé : il suffit d'une situation sérieuse pour faire tout basculer.
Bref, en repartant nourri à la bataille, qui revêtait maintenant quelque ampleur (il devait être dix heures ou dix heures et demie de la soirée) car il y avait foule — même si ne s'activaient que quelques centaines de personnes à la manœuvre —, j'avais presque oublié le plan que nous avions dressé la veille afin de semer la pagaille dans les commissariats : profiter de la confusion ambiante en allant, par petits commandos, briser les vitrines des plus grandes bijouteries, ce qui, du fait de leur connexion directe par alarmes électriques avec les postes de police, ne devait pas manquer d'affoler les centres stratégiques de la répression locale.
Cependant, la force dite publique recevait enfin des colonnes de renforts dépêchées de Dordogne et de La Rochelle. Ces Compagnies républicaines de sécurité, qui s'entendaient traiter de SS par la populace, n'étaient pas vraiment à la noce. Mais elles disposaient d'un armement plus offensif (grenades et gaz chlorés) et de plus longue portée que les insurgés.
C'est très exactement ainsi, en comptant les erreurs tactiques — contre notre avis, cent ou deux cents barricadiers se retranchèrent dans la vieille faculté des lettres où ils se retrouvèrent assiégés et gazés —, que nous perdîmes la bataille engagée. Vers deux heures et demie du matin, une négociation du doyen et des bureaucrates patentés obtint que blessés et valides soient évacués ou puissent rentrer chez eux sans être autrement inquiétés. Nous sûmes néanmoins dès le lendemain que les services d'action chabanocivique ne s'étaient pas fait faute de ratonner quelques étudiants assez naïfs pour regagner isolément leurs pénates.
Les rumeurs les plus diverses ont évidemment couru sur le nombre de victimes de cette chaude nuit. Il se trouve que je sais de pertinente source —en l'occurrence celle de l'ennemi — que le combat se solda par quatre morts : deux au moins, parmi les compagnies RS, ne font guère de doute, et très probablement deux émeutiers, l'un écrasé par un camion fou d'argousins qui se jeta sur l'une des dernières barricades, bien édifiée, qui barrait l'accès du cours Pasteur au débouché de la place de la Victoire, et un autre, réfugié dans la tour Pey-Berland, qui, le bras arraché par une grenade offensive, ne put être secouru à temps.
La guerre sociale est cruelle. Mais à Bordeaux elle s'arrêta net là. Je fus pour ma part gaillardement dénoncé comme « trafiquant de filles, de drogue et chef de gang » par l'un de mes professeurs qui m'avait fait convoquer par le conseil de l'université pour m'y sanctionner en ce même mois de mai. Conseil ajourné en raison de l'occupation des locaux… (Pour la petite histoire, il se trouve que le professeur en question était la veuve du surréaliste Jean Carrive, une Alsacienne qui avait réussi sa conversion en Bordelaise en quelque sorte.)
Dans le pays paralysé par une dizaine de millions de salariés en grève sauvage, les bureaucrates syndicaux et politiques durent risquer leur va-tout : il fallut annuler le malheureux référendum annoncé par De Gaulle et dissoudre la Chambre des députés. Mais surtout, en réquisitionnant les dépôts de distribution d'essence, on put enfin rétablit l'ordre meurtrier des autoroutes pour le dernier week-end de ce mois de turbulences. La gueule de bois qui suivit en France ces bacchanales de la vérité, où bien peu de monde était resté sobre, fut amplement illustrée par la reprise chez Wonder et ailleurs. Nous fûmes quelques-uns à nous exiler prudemment.
Arsène Darchamier
(alias Christian Marchandier dit Arthur)
1) Mais voilà-t-il pas qu'un énième livre encensant l'Insurrection situationniste, d'un certain Laurent Chollet (éditions Dagorno, 2000), se met en devoir de nous apprendre que Jean-Pierre Bouyxou serait venu aider les vandalistes à rédiger ce Crève, salope ! — puisqu'il faut enfin adopter l'appellation qui est restée attachée à la plus belle répétition d'un texte sans intitulé…
Foutre ! Si, en ce Bordeaux où tenions nos états, à l'automne 1967 l'underground Bouyxou avait à moitié organisé une vague soirée semi-clandestine, où nous vîmes en particulier les percutants métrages d'Étienne O'Leary (enfumés des vapeurs fort haschichines de leur auteur) dans une obscure salle derrière le marché Victor-Hugo, nous sommes encore quelques protagonistes à savoir que le pauvre hère artiste se tenait même à l'écart de tentatives moins audacieuses.
Ainsi, un mille et unième témoignage sur Mai 68 vient boucler,
avec quelque quatre cents lunes de retard, les analyses les plus pertinentes
de cette époque controversée. Ne citons que pour mémoire les plus émouvantes :
André MALRAUX, Les Rosiers qu'on abat (Gallimerde, 1971).
François MITTERRAND, La Grenouille et le marécage (P.U.F., 1974).
Jacques DUCLOS, Nous l'avons tant trahie, la révolution (Éditions de la pérestroîka, 1990).
Patrick HAMAN et Hervé ROTMON, Les Années de rêve de la gauche caviar (Seuil, 1978).
Daniel COHN-BENDIT, Discours aux étudiants et aux journalistes (Éditions France-Soir/RTL, 1968) ;
Les Barricades sans peine (Assimil, 1969) ;
Mes Nuits chez les Misoffe (Harlequin, 1975).
 Tags : arthur
Tags : arthur
jean-claude leroy